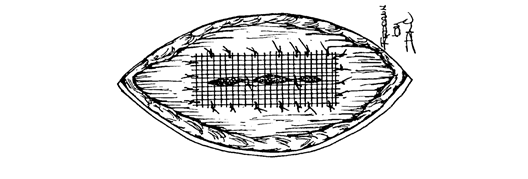mardi 17 novembre 2015
dimanche 15 novembre 2015
La chirurgie des hernies
By:
Dr Vétérinaire
On: 10:07
La chirurgie des hernies
Introduction :
La hernie est la protrusion d’un organe ou d’une
portion d’organe au travers d’une ouverture anormale existant dans les tissus
voisins. Le terme est couramment employé pour désigner le passage d’organes au
travers de la paroi abdominale.
Les hernies se classent selon leur type et leur
emplacement. Selon le type on distingue :
1) les hernies réductibles : le contenu
herniaire peut être remis en place dans la cavité abdominale
2) les hernies irréductibles : le contenu
herniaire ne peut être remis en place qu’après intervention chirurgicale.
L’irréductibilité est due a des adhérences qui ont été contractées avec les
tissus voisins
3) les hernies étranglées : le
collet de la hernie est resserré au niveau de l’anneau herniaire ce qui
entraine une stase sanguine avec ultérieurement apparition de gangrène de la
partie intestinale herniée.
Matériaux employés
pour la réparation des hernies :
Tous
les types de hernie, selon leur emplacement, leur taille et peut être leur
ancienneté, conduisent a utiliser des matériaux de prothèse pour faciliter la
fermeture et renforcer une paroi musculaire faible ou incomplète. De nombreux
types de matériaux peuvent être employé pour fournir un appui solide : la
peau, le fascia, les filets métalliques ou en plastiques (les plus employé dans
la prothèse réparatrice des hernies chez les animaux) sont au nombre d’entre eux.
La réparation des
hernies :
I) Hernies
ombilicales
Etiopathogénie :
Les
hernies ombilicales congénitales résultent d’un défaut de fermeture de l’anneau
ombilical ou d’une anomalie du développement ou d’une hypoplasie du muscle
droit de l’abdomen et de l’aponévrose des muscles obliques de l’abdomen .Dans les deux cas il existe un
défaut des muscles et de l’aponévrose de l’abdomen à travers lequel le
péritoine forme une poche .La hernie ombilicale acquise peut résulter d’une section
du cordon ombilical trop prés de la paroi abdominale par la chienne ou par
l’homme .Cette hernie peut entraîner une éviscération .
La hernie ombilicale est une sortie du contenu abdominal à
travers un ombilic resté ouvert .La
hernie peut contenir de l’épiploon, ou n’importe quel organe abdominal. La paroi de la
hernie comprend habituellement la peau, le tissu sous-cutané et le péritoine.
La
hernie ombilicale est plus facile à diagnostique les hernies des autres régions
mais elle doit distinguée d’un abcès, d’un phlegmon ou d’une tumeur de la peau
ou du derme. Une masse petite et ferme indique la présence d’épiploon, de
ligament falciforme ou de graisse. Un masse plus volumineuse peut indique
présence d’intestin grêle. En cas d’étranglement l’intestin peut être augmenté
de volume et douloureux et être souvent irréductible.
Traitement :
L’opération
est ma méthode de traitement le plus souvent utilisée mais une guérison
spontanée peut se produire. Un orifice ombilical petit peut se réduire avec la
croissance de l’animal et ne laisser qu’un petit default de la paroi abdominale.
Un traitement chirurgical rapide est nécessaire en cas de hernie volumineuse,
de hernie de l’intestin avec étranglement .D’hypoplasie ou de malformation de
la paroi abdominale.
L’incision
cutanée est fonction de la taille de la hernie. Pour les petites hernies, on fait au
dessus de la hernie ou de l’anneau une incision simple les dépassant légèrement
vers l’avant et vers l’arrière. Quand la hernie est volumineuse et que la peau
est en excès, on fait une incision en coté de melon quatre fois plus longue que
large pour permettre une suture esthétique la peau (fig.1).
Figure
1 : A) en cas de hernie ombilicale
volumineuse, on élimine par une incision elliptique la peau sus-jacente en
excès en même temps que le sac herniaire. B) réparation de la paroi abdominale
après élimination du sac herniaire
Sur
l’animal en décubitus dorsal, la hernie peut se réduire spontanément et le sac
péritonéal rentrer et dissparaitre dans l’abdomen. Dans ce cas, on peut fermer
l’anneau herniaire sans pénétrer dans la cavité péritonéale. Dans les hernies
volumineuses le péritoine peut adhérer au tissu sous-cutané et à la peau ainsi
qu’aux organes abdominaux, dont il faut le libérer. Dans ce cas on pratique une
réduction « à découvert » en éliminant le péritoine formant le sac
herniaire. On répare le défaut par des points séparés de ligature résorbable
synthétique 2-0 ou 3-0 (fig. .2).
Des
sutures utilisant l’acier peuvent être nécessaires pour les hernies
volumineuses chez les chiens de taille moyenne à géante. L’hypoplasie des
muscles et de l’aponévrose peut exiger l’utilisation d’un treillis à titre
d’implant servant de support et de charpente pour la cicatrisation (fig.3).
Figure
3 : dans les hernies par
hypoplasie congénitale l’implantation d’un treillis fournit un support et une
charpente a la cicatrisation
La
fermeture des anneaux herniaires volumineux peut tendre exagérément les fils de
suture. On peut alors faire de chaque coté une incision de détente sur le
fascia du muscle droit de l’abdomen (fig. 4) en évitant le muscle et le fascia
profond pour prévenir une hernie iatrogène. On peut aussi mettre en place
plusieurs grands points en U de détente à quelques centimètres sur les cotés de
la suture de l’anneau.
Figure 4 : des incisions
de détente faites sur le fascia du muscle droit contribuent à réduire les tensions
sur la suture dans la hernie ombilicale volumineuse
Soins postopératoires :
Il
est préférable de limiter l’activité de l’animal pendant une semaine ou plus
après l’opération en fonction de l’importance de la hernie.
II) HERNIE INGUINALE
Etiologie :
Chez
le chien male cette hernie peut transformer en hernie inguinoscrotale. La
plupart animaux atteints présentent probablement une prédisposition anatomique
et peut être aussi une prédisposition héréditaire. Du point de vue anatomique, les hernies inguinales
sont classées en hernies directes et hernies indirect. La hernie
directe est un engagement indépendant du péritoine dans le canal inguinal ne concernant
pas la tunique vaginale et elle est la forme la plus souvent observée chez les
animaux domestiques.
Anatomie :
Des
anomalies anatomiques de la région inguinale peuvent prédisposer à la hernie. Si
la taille de l’anneau inguinal inferieur varie peu d’un animal à l’autre, ce de
l’anneau inguinal supérieur peut varier en fonction de l’extension vers
l’arrière du muscle oblique interne de l’abdomen.
La
cavité de la vaginale, c’est à dire l’espace entre sa paroi péritonéale et son contenu,
communique avec la cavité abdominale par un orifice en forme de fente à
l’origine de la vaginale. Dans la hernie
indirecte les viscères pénètrent dans la vaginale par cet orifice. Le ligament rond
est probablement la cause de la pénétration d’une corne utérine ou de l’utérus dans la tunique
vaginale lors de hernie. La tunique vaginale forme sac herniaire et couvre les
viscères en même temps que le ligament rond ou le cordon testiculaire. Un élargissement
de l’orifice de la tunique vaginale est probablement un facteur important
prédisposant à la hernie.
Diagnostic
La plupart des hernies inguinales
apparaissent comme une augmentation de volume unilatérale, molle, pâteuse et
non douloureuse.
Le
diagnostic est simple si la hernie est réductible et que l’anneau herniaire est
palpable. Une élévation de l’arrière-train de l’animal en décubitus dorsal peut
faciliter le diagnostic en diminuant la pression intra abdominale. Les hernies irréductibles peuvent être
dues à un étranglement, à une rétention d’urine dans la vessie herniée ou au
développement de fœtus dans l’utérus. Dans leur cas, le diagnostic peut être
plus difficile et l’augmentation de volume doit être distingué d’une tumeur mammaire.
Une augmentation de volume peut être due à des dépôts graisseux sur le ligament
rond distendant la tunique vaginale en l’absence de hernie. La radiographie peut
être utile en cas de difficulté. L’utérus gravide apparaît comme une
densité liquidienne lobulée avec des squelettes de fœtus, si la gestation est
assez avancée. Les radiographies avec préparation de l’appareil digestif et
urinaire sont utiles dans certains cas.
Traitement :
Une incision
abdominale médiane peut être utilisée dans tous les cas de hernie inguinale.
Elle permet de voir les deux annaux inguinaux et de réparer les hernies bilatérales. Elle permet aussi d’étendre
l’incision vers l’avant en cas de besoin sans attaquer la mamelle et ses
vaisseaux.
L’incision
s’étend du bord du pubis vers l’avant, autant qu’il est nécessaire pour
découvrir le sac herniaire (fig. 2a). On approfondit l’incision jusqu’à la
gaine du muscle droit. On décolle la mamelle
et on la récline vers le dehors pour découvrir l’anneau inguinal et le sac
herniaire. On sépare celui-ci du tissu sous-cutané par dissection mousse
(fig. 2b). On ouvre le sac herniaire et on inspecte son contenu .On rompt les
éventuelles adhérences des viscères avec le sac et on renvoi le contenu dans l’abdomen (fig. 2c).
Il est parfois
nécessaire d’agrandir l’anneau herniaire vers l’avant pour faciliter la
réduction. L’aspiration
de l’urine facilite la réduction en cas de hernie de la vessie. En
cas de hernie d’une ou des deux cornes
utérines, l’ovariohystérectomie est nécessaire ou souhaitable et l’incision
peut avoir à être agrandie aussi loin vers l’avant e le dedans qu’il est
nécessaire pour la réaliser
Après remise
en place des organes dans l’abdomen, on pare le sac herniaire en excès au
niveau de l’anneau inguinal et on suture celui-ci par des points séparés
simples d’acier 2-0 (fig. 2d).
Au cours de cette
suture, il faut veiller à préserver les vaisseaux et les nerfs honteux
externes sortant en partie médiale et postérieure de l’anneau. On inspecte
l’autre anneau inguinal, on ampute la tunique vaginale et on ferme l’anneau par
une suture .On ramène la mamelle vers la ligne médiane et on applique un drain
de penrose, on répare la peau de la façon habituelle.
Figure 2 : A) schéma de la
tunique vaginale et de l’anneau inguinal. La ligne en tirets indique le tracé
de l’incision en vue de la réparation de la hernie inguinale. B) région
inguinale découverte montrant la tunique vaginale contenant les organes
herniés. Noter les vaisseaux et le nerf honteux. C) la tunique vaginale à été
libérée par dissection. D) suture de l’anneau inguinal
Soins post opératoires :
On
applique un pansement sur la partie postérieure de l’abdomen en laissant une
ouverture pour le drain. Le pansement élimine les espaces morts et augmente le
confort du patient .On retire le drain 3 à 5 jours après l’opération avant de
renvoyer l’animal.
III) HERNIE DISCALE
LOMBAIRE
La
colonne vertébrale (ou rachis) est constituée de 24 os (vertèbres) empilés les
uns sur les autres. Chaque vertèbre est trouée à l’arrière et l’ensemble de ces
trous forme un canal (le canal rachidien).
Les
fibres nerveuses qui transmettent les ordres de mouvement envoyés par le
cerveau aux différentes parties du corps circulent dans ce canal. Dans le bas
du dos, au niveau des vertèbres lombaires, une partie de ces fibres forme ce
que l’on appelle la queue de cheval (fig. 1)
Avec les années, le disque intervertébral situé entre
deux vertèbres peut s’abîmer. S’il déborde dans le canal, il risque de comprimer un
nerf à l’endroit où celui-ci sort de la colonne vertébrale (racine
nerveuse) ou la queue de cheval. On parle de hernie discale lombaire. La
compression d’un nerf provoque d’intenses douleurs dans le dos, mais aussi dans
la jambe.
Figure
1 : physiopathologie de la hernie discale lombaire
Si
c’est le nerf crural qui est comprimé, les douleurs touchent l’avant de la
jambe (cruralgie). Quelquefois, le nerf ne transmet plus correctement les
informations et certaines zones du corps ne bouge plus correctement (paralysie).
Si les nerfs
de la queue de cheval sont touchés, cela peut provoquer des problèmes pour
uriner, une impuissance... On appelle cette atteinte le syndrome de la queue de
cheval. Il faut alors intervenir très rapidement.
Le
plus souvent, un traitement médical suffit à supprimer les crises de douleurs
de la sciatique ou de la cruralgie. Si les douleurs persistent, ou s’il ya des
signes d’insensibilité ou de paralysie de certaines zones du corps, une
intervention chirurgicale est indiquée.
Technique
chirurgicale :
Selon
le cas et les habitudes du chirurgien, on peut opérer de deux façons :
1)
de manière classique, en ouvrant dans le dos sur quelques centimètres ;
2)
en introduisant de fins instruments et une petite caméra par quelques petites
ouvertures et on opère alors en visualisant l’intérieur du corps sur un écran
(technique endoscopique).
L’intervention
se fait sous anesthésie générale
Le chirurgien
met délicatement de côté la racine nerveuse pour la protéger. S’il blesse accidentellement un nerf
ou la queue de cheval, cela peut provoquer des insensibilités ou une paralysie.
Il enlève la
hernie progressivement, en plusieurs petits morceaux. Si c’est nécessaire pour éviter que
la hernie ne revienne rapidement (récidive précoce), le chirurgien retire
d’autres morceaux du disque (fig. 2)
Figure
2 : retrait de la hernie discale lombaire
En
opérant, le chirurgien risque de couper un vaisseau sanguin. Cela peut entraîner
d’importants saignement (hémorragie), et exceptionnellement la mort. Le chirurgien
peut également blesser l’enveloppe remplie de liquide qui se trouve entre la
queue de cheval et l’os (la dure-mère) et de provoquer une fuite. Il doit alors
la réparer.
L’opération
dure généralement entre 40 minutes et deux heures.
dimanche 8 mars 2015
"L ’infertilité bovine : un syndrome ppt" par le Prof. Ch. Hanzen 2015
By:
Dr Vétérinaire
On: 12:35
L’infertilité
bovine : un syndrome
-Par : Prof. Ch. Hanzen
Faculté de médecine vétérinaire de Souk Ahras
Mars
2015
jeudi 5 mars 2015
Anoestrus post_partum
By:
Dr Vétérinaire
On: 05:56
Anoestrus post_partum
La durée de
l’anoestrus du postpartum peut être définie au moyen de plusieurs critères.
· Cliniquement,
le post-partum se caractérise par une période d'anoestrus comportemental plus
ou moins longue selon les
races. Si les
conditions de détection de l'oestrus sont optimales, elle est selon les auteurs
de 30 à 70 jours chez la vache
laitière. Chez
la vache allaitante, elle est beaucoup plus variable et est comprise entre 30
et 110 jours.
· Le
dosage dans le lait ou le sang de la progestérone a permis d'établir que 88 %
des animaux de race laitière présentent
une structure
lutéale 35 jours après le vêlage et 95 % après 50 jours. La première
augmentation de la progestérone
apparaît selon
les auteurs entre 16 et 69 jours après le vêlage chez la vache laitière et
entre 56 et 96 jours chez la vache
allaitante.
· Les
études échographiques de la croissance folliculaire ont permis de caractériser
de manière plus précise la croissance
folliculaire
au cours des premières semaines du postpartum chez la vache laitière et
allaitante. De manière synthétique, on retiendra que le processus de la
croissance folliculaire est comparable dans les deux types de spéculation :
population
folliculaire entre le 5ème et le 10ème
jour du postpartum constituée de follicules de petite taille chez
la vache
laitière et de
taille moyenne chez la vache allaitante et apparition d’un follicule dominant
entre le 10ème et le 15ème
jour du
postpartum. Le
devenir du folliucle dominant est cependant différent. Il ovule beaucoup plus
fréquemment chez la vache
laitière
qu’allaitante ce qui se traduit dans cette seconde spéculation par un
intervalle entre le vêlage et la première
ovulation 2
fois plus long en moyenne que chez la vache laitière.
Chez la vache
laitière, au cours de la première semaine du postpartum, la population
folliculaire est essentiellement constituée de
follicules de
diamètre inférieur à 4 mm. Les premiers signes de croissance folliculaire
apparaissent 5 jours environ après le vêlage.
Entre ce
moment et la présence du premier follicule dominant, ils observent la
croissance et la régression de follicules pouvant
atteindre 8 mm
de diamètre. Le premier follicule dominant (unique et de taille supérieure à 10
mm) apparaît en moyenne 12 jours (5
à 39) après
l'accouchement. Ce premier follicule dominant ovule dans 74 % des 19 cas
étudiés, devient kystique dans 21 % des
cas et après
régression est suivi de l'apparition d'un nouveau follicule dominant dans 5 %
des cas. D’autres études ont décrit chez la
vache laitière
trois types de développement folliculaire basés sur le devenir du follicule
dominant de la première vague de croissance
folliculaire.
Dans 46 % des cas il y a ovulation, 20 jours en moyenne après le vêlage. Cette
croissance folliculaire s’accompagne
d’une synthèse
d’oestrogènes par le follicule. Dans 31% cette première vague ne s’accompagne
pas d’ovulation mais est suivie d’au
moins deux
autres vagues. Cette première croissance folliculaire ne s’accompagne pas d’une
synthèse d’oestrogènes, le follicule
s’atrésie.
Dans 23 % des cas enfin, le follicule dominant de la première vague devient
kystique. Il secrète des oestrogènes. Dansces deux derniers cas, l’intervalle
entre le vêlage et la première ovulation est respectivement de 51 et 48 jours.
Ces divers schémas
de croissance folliculaire ne sont pas sans relation avec la durée variable des premiers cycles au cours du postpartum. Ainsi, après
la première
ovulation, on observe un cycle de durée normale (22 jours environ avec 2 à 3
follicules dominants) dans 30 % des cas.
Le cycle est
raccourci (9 à 13 jours : 1 follicule dominant) dans 30 % des cas. Il est
allongé (45 jours en moyenne : 3 à 4 follicules
dominants)
dans 40 % des cas. La précocité d'apparition du follicule dominant influence la
durée du cycle subséquent. Plus précoce
est la
détection du follicule dominant (< 9 jours PP), plus élevée sera la
proportion de cycles d'une durée supérieure à 25 jours. A
l'inverse, une
détection tardive (> 20 jours PP) s'accompagne habituellement d'un
raccourcissement du cycle (9 à 13 jours). Enfin, il
a été observé
que l'intervalle moyen entre le vêlage et l'identification du premier follicule
dominant est plus court lorsque
l'accouchement
est observé en automne (6,8 jours) par rapport au printemps (20 jours).
A l’inverse de
la vache laitière, la vache allaitante présente avant le moment de la première
ovulation davantage de follicules de taille
moyenne (4 à 9
mm) au cours des deux premières semaines du postpartum. D’autres auteurs ont
également observé une
augmentation
du nombre de follicules de diamètre compris entre 4 et 8 mm entre le 7ème
et le 42ème jour postpartum.
Le premier
follicule dominant est présent 10 jours en moyenne après le vêlage mais
celui-ci n'aboutit à une ovulation que dans 20 %
des cas (2 sur
18) soit 3,5 fois moins souvent que chez la vache laitière. L’intervalle entre
le vêlage et la première ovulation est de
36 jours en
moyenne (20 à 61 jours). Il est donc pratiquement deux fois plus long que chez
la vache laitière. L'intervalle entre la
détection d'un
follicule de diamètre supérieur à 14 mm et l'ovulation est plus long chez les
primipares (42,7 jours) que chez les
pluripares
(13,5 jours). La détection d'un tel follicule ne revêt donc une valeur
pronostique d'un oestrus que chez les pluripares.
L'anoestrus
caractéristique de cette spéculation résulte donc davantage d'une absence
d'ovulation que d'une insuffisance de
développement
du follicule dominant. Le plus souvent le premier cycle est de courte durée (12
jours en moyenne).
Chez la vache
viandeuse comme chez la vache laitière ), on a décrit la présence au cours du
postpartum de follicules dominants de
diamètre de 9
à 10 mm qui persistent pendant au moins une semaine et parfois 35 voire 52
jours sur l'ovaire en l'absence de corps
jaune et de
kystes et peuvent s'accompagner d'anoestrus ). Plus rarement (2 cas sure 18),
ils peuvent ovuler en l'absence de
traitement.
Plus rarement encore (1 cas sur 18) ils peuvent régresser et un nouveau
follicule persistent apparaître sur l'ovraire
contralatéral.
La raison de cette persistence pourrait en être la suivante. La présence d'une
progestéronémie faible ou
l'administration de progestagènes
peut s'accompagner d'une pulsatilité moyenne de la LH (1 pulse par heure voire
toute
dimanche 8 février 2015
Inscription à :
Articles (Atom)




.jpg)


.jpg)